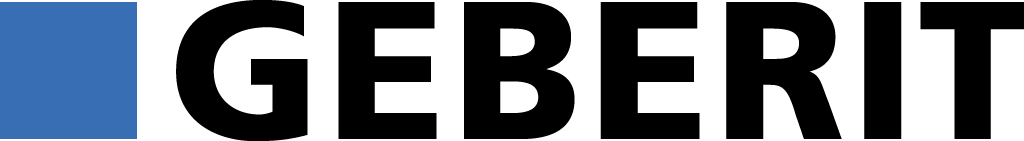Langage courant, euphémismes, expressions familières, en argot ou en patois… La langue française serait-elle celle qui compte le plus de mots pour parler des toilettes ?
« Toilettes n.f. pl. Lieux d’aisances, en particulier dans un endroit public » nous dit le Larousse qui compte par ailleurs un nombre incalculable de mots pour désigner les commodités. Combien exactement ? Difficile à dire. La langue française fait la part belle aux pudiques termes euphémistiques, tandis que les expressions désignant les toilettes en langage familier, en argot ou en patois se comptent par centaines.
Quels termes désignent les toilettes dans la langue française ?
Si le mot “toilettes” est le plus couramment utilisé en France, il est souvent remplacé par le sigle WC, abréviation du terme anglais water closet. Apparu outre-manche dans les années 1870, le mot water closet signifiait à l’origine « wash-down closet » (soit littéralement “placard à eau”), avant d’évoluer en water closet puis WC au fil du temps. Les Français peuvent également utiliser le mot water, ou encore wawa, un raccourci jugé plutôt familier.
Les cabinets, le petit coin, les commodités… Parler des toilettes sans évoquer ce qui s’y passe relève de l’art de l’euphémisme dans la langue française. Formule élégante devenue aujourd’hui un peu plus vieillotte, les cabinets viennent du mot singulier « cabinet » qui désignait une petite pièce privée destinée à recevoir ou à se retirer dans un cadre plus intime, devenue par extension les cabinets d’aisance, l’espace accueillant les toilettes. En revanche, l’expression « aller aux cabinets » appartient à un registre plus familier. Une personne souhaitant évoquer de manière pudique et polie les toilettes, parlera du petit coin. Terme plus particulièrement utilisé par votre plombier, les sanitaires, désigne les espaces dédiés à l’hygiène dans une habitation, c’est-à-dire les toilettes, mais aussi la salle de bains.
Plus souvent utilisé dans un contexte militaire ou historique, le terme latrines désigne généralement des installations sanitaires très simples qui ne sont généralement pas raccordées à un réseau d’égouts ni à un système de plomberie moderne et situées à l’extérieur de l’habitation.
Les toilettes, territoire favori du langage familier et de l’argot
Si le langage soutenu préfère rester évasif sur nos passages aux toilettes en maniant l’euphémisme de bienséance, le langage familier et l’argot ont fait des toilettes leur terrain de jeu. Avec tout un florilège de mots fleuris, on parlera de pipi-room, de tinette, de trône, de chiottes, de goguenots, de gogues, de pissotières et de bien d’autres.
Les déclinaisons géographiques du mot Toilettes
Dans nos régions, le mot toilettes s’occitanise, se picardise ou se parisianise en fonction de sa géographie. On vous désignera volontiers les cagoinces ou les zinzins dans certaines parties du Nord et de la Picardie. Peu utilisé dans la langue française, le cadagou est un mot occitan utilisé dans le Sud-ouest alors qu’en Provence, on parlera des cabèches. Les Canadiens francophones utilisent plutôt le terme de bécosse, dérivé de l’anglais back house, qui signifie « derrière la maison », lieu où les toilettes étaient souvent aménagées, tandis que les Belges lui préfèrent le mot binoche, un nom familier donné aux toilettes.