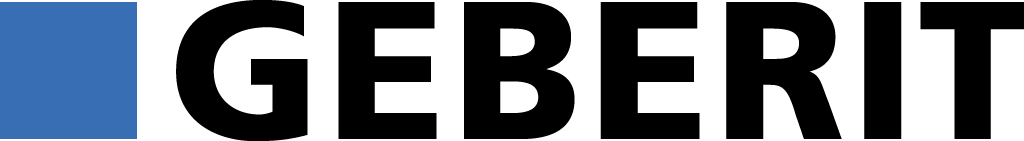Des vespasiennes aux sanisettes modernes, l’histoire des toilettes publiques témoigne des progrès accomplis en matière de confort, d’inclusivité et de respect de l’environnement.
Alors que la civilisation Aztèque avait déjà mis en place des toilettes publiques construites à l’aide de roseaux, que la Rome antique équipait ses cités de latrines publiques et que la Chine se dotait des premières toilettes publiques au Iᵉʳ siècle après J.-C., l’Europe médiévale semble avoir connu un recul notable en matière d’hygiène publique. Pendant plusieurs siècles, les villes deviennent insalubres, les toilettes disparaissent de l’espace public, et les rues se transforment en véritables dépotoirs où sont jetées les ordures, les eaux usées et l’urine. Il faudra attendre le début du XIXe siècle pour que les premiers urinoirs fassent leur apparition dans les rues de Paris.
Apparition des premiers urinoirs
Au XIXe siècle, la révolution industrielle entraîne une croissance urbaine sans précédent. Dans la plupart des villes, la population est multipliée par dix et se concentre dans des espaces restreints, favorisant les risques sanitaires. Face à cette croissance démographique spectaculaire, la nécessité d’améliorer l’hygiène publique devient une priorité. En 1834, après une épidémie de choléra qui a ravagé Paris, le comte de Rambuteau, préfet de la Seine sous Louis-Philippe, s’inspire des théories hygiénistes, alors en vogue en Europe, pour lancer de vastes travaux de réaménagement et d’assainissement dans la capitale. On doit notamment à Rambuteau l’installation de 478 urinoirs publics sur les trottoirs parisiens. D’abord appelés « colonnes Rambuteau », ces urinoirs publics sont rapidement surnommés « vespasiennes », en référence à l’empereur Vespasien, qui, vers l’an 70, aurait instauré un impôt sur l’urine collectée dans les lieux publics de Rome.
La vespasienne, un élément du paysage urbain parisien
Au fil du temps, la vespasienne parisienne se perfectionne et connait quelques améliorations en matière de confort et d’intimité. À l’origine en forme de colonne ouverte, elle évolue en cabine métallique qui offre un peu plus d’intimité et se dote d’un éclairage. Largement démocratisée, la vespasienne marque une étape importante dans l’histoire de l’hygiène dans l’espace publique et une grande avancée pour le maintien de la propreté dans les rues de la capitale. Cependant, cette installation, uniquement réservée aux hommes, exclut les femmes et les personnes à mobilité réduite de l’accès à des toilettes publiques.
Les sanisettes, une nouvelle ère de l’hygiène publique
À l’aube des années 1980, les vespasiennes devenues obsolètes et malodorantes sont remplacées par les premières sanisettes. Ces nouvelles installations, conçues pour répondre aux exigences de la société moderne, apportent plus de confort et de discrétion. Plus sophistiquées, elles sont équipées de systèmes automatisés permettant le nettoyage complet de la cabine après chaque utilisation. Contrairement aux pissotières, les sanisettes sont entièrement fermées et aménagées pour accueillir aussi bien les hommes que les femmes. Ce n’est qu’en 2009, avec une nouvelle génération de sanisettes, que des cabines accessibles aux personnes à mobilité réduite seront mises en place en France.
Plus inclusives et plus respectueuses de l’environnement, les sanisettes sont aujourd’hui accessibles gratuitement à tous dans l’espace public. Les instructions disponibles dans plusieurs langues, ainsi qu’en braille, peuvent être transmises par voie sonore. Enfin, elles consomment 30 % moins d’eau et sont peu énergivores grâce à un éclairage naturel et un éclairage d’appoint à faible consommation.